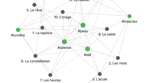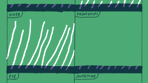cailloux n°124
cliver ou décaler ?


cailloux*
5 min ⋅ 16/06/2025
Je ne vous écris pas souvent, mais quand j’écris je veux que vous en ayez pour votre argent alors cette fois, je vous propose des opinions clivantes. Pas pour cliver, ce ne serait pas très intéressant, mais pour décaler, j’espère.
Il y a quelques mois, j’ai vu passer sur internet une “roue des privilèges”, qui m’a tout d’abord frappée par ses incohérences (on trouve par exemple “LGBTQIA” dans la catégorie “Orientation sexuelle”, or être trans ou intersexe ne relève pas de cette catégorie). Et puis j’étais franchement gênée aux entournures car je trouvais cette roue parfois arbitraire et simpliste dans son classement des catégories et finalement assez dépolitisante (en contradiction avec l’intention évidente de la personne qui l’a créée, que je ne critique pas ici). Et bien l’article La souffrance individuelle (et collective) est-elle politique ? de Chi-Chi Shi (traduit de l’anglais par Sophie Coudray et Selim Nadi), m’a permis de comprendre pourquoi.
C’est une lecture peu velue, ça aurait mérité d’être raboté ici ou là, mais ça donne à réfléchir. D’ailleurs d’autres personnes proposent des versions vulgarisées du texte, ici et là.
Pour ma part je vais tenter d’en faire un très bref résumé : l’autrice, docteure en théorie politique et géographie, critique les théories politiques du privilège et de l'identité. Ces théories sont dérivées de la pensée de Kimberlé Crenshaw qui a inventé le terme d'intersectionnalité, et, dit-elle, se focalisent sur l'oppression des individus, avec des descripteurs conçus comme statiques et intemporels, et non sur la cause de l’oppression.
Elle identifie l’évolution de ce discours militant comme étant en lien avec les politiques néolibérales qui, par essence, cherchent à privatiser les ressources collectives. Dans le cas de la lutte politique, cela se manifeste par une "marchandisation du soi" des personnes opprimées via des discours de résilience et de développement personnel face à la souffrance que produit l'oppression dans leur vie.
Elle propose de replacer le collectif comme force politique, au-delà de “l'autoréflexion comme résistance” qu'entraînent les théories du privilège, et de refuser la concurrence entre opprimés pour construire un "Nous" afin de construire de nouvelles possibilités.
En très bref, donc.
*
Je lis et j’entends fréquemment des critiques très virulentes de la psychanalyse – parfois de la part de personnes qui ne connaissent pas beaucoup ni la psychanalyse, ni les autres types de thérapies qu’elles estiment être plus acceptables d’ailleurs. L’argument principal soutient que la psychanalyse (et les psychothérapies qui s’y réfèrent) serait une pseudoscience. Cet article de Guénaël Visentini, docteur en psychologie, L’efficacité de la psychanalyse, vise à démontrer qu’il s’agit d’une méconnaissance de la discipline. La psychanalyse a intégré l’évaluation de son efficacité dès ses débuts, et on sait (et ça je l’avais déjà appris au début de mes études quand j’étudiais à l’université de Genève, pas franchement réputée pour son amour de la psychanalyse) que :
parmi les formes conceptuellement structurées et historiquement reconnues de psychothérapie, pratiquées de bonne foi par des thérapeute rigoureusement formés (on y inclut la psychanalyse, les TCC, les thérapies systémiques, ou les thérapies interpersonnelles) il y a globalement une égalité d’efficacité, relativement à l’ensemble des troubles connus. Quand il y a des différences, elles sont considérées comme marginales.
Et que globalement, ce qui compte pour 30% des effets c’est la mise en sens du vécu, l’identification au thérapeute, les suggestions du thérapeute… bref, la relation thérapeutique, indépendamment du référentiel théorique du psy.
Le second argument est que Freud était sexiste, et il est certes important de lire Freud (et tous les autres à sa suite) avec un regard critique, mais heureusement, il s’est passé plus de cent ans depuis les débuts de la psychanalyse et quelques autres personnes y ont réfléchi – tout comme les TCC se sont développées et ont évolué depuis B. F. Skinner (ouf).
Et puis, je crois qu’il y a parfois une confusion entre la psychanalyse (et ses dérivés) comme technique psychothérapeutique et comme théorie quant à l’étiologie (la cause) des troubles psychiques. Sur ce point, j’avais déjà écrit sur ma méfiance quant aux diagnostics – psychiatriques, psychanalytiques, quels qu’ils soient – il y a 3 ans :
On a parfois tendance à penser qu’un diagnostic, par exemple “TDAH” ou “dépression” est une entité naturelle discrète (ce n’est jamais le cas, la comorbidité est la règle et pas l’exception), qui contiendrait une sorte de vérité essentielle et immuable.
Je dis “méfiance”, c’est un euphémisme. Plus le temps passe, moins je suis convaincue de l’utilité des diagnostics, qui en psychiatrie ne permettent pas – à l’heure actuelle – de déterminer la cause (génétique, environnementale, épigénétique…) du trouble, et qui donnent l’illusion que puisqu’on peut le nommer, on saurait alors ce qui l’a causé, comment le traiter, comme on le fait en médecine somatique (ou pas, d’ailleurs). Des diagnostics dont on pourrait également débattre de la scientificité. Des diagnostics qui trop souvent figent dans une catégorie perçue comme statique et intemporelle. Qui ne permettent pas de s’ajuster aux besoins spécifiques de la personne.
Plus le temps passe, donc, moins je suis convaincue de l’utilité des diagnostics, et plus je suis persuadée que ce qui est indispensable, c’est changer la société, notre capacité à accueillir la souffrance et l’accompagner, notre volonté de s’adapter à la singularité de chaque sujet et donc surtout notre rapport à la norme et à la “normalité”.
Enfin, je crois que certaines de ces critiques sont issues d’expériences avec des psychothérapeutes se réclamant de la psychanalyse et qui exercent de la violence et des discriminations à l’égard de leurs patient’es. Et ça, malheureusement, cela arrive car les psys sont des gens issus de la société (une frange assez spécifique au niveau social par ailleurs) et n’échappent donc pas au racisme, sexisme, transphobie, homophobie, validisme, etc. qui imprègnent la société. Et même si ces personnes tentent de justifier leur violence par la psychanalyse, il n’en reste pas moins que c’est là un problème politique, pas psychanalytique (un peu comme : le monde ne sera pas magiquement moins violent si on supprime les religions, n’en déplaise à certains athées intégristes)(c’est un problème de politique, pas de religion)(vous voyez l’idée).
*

D’ailleurs sur le sujet du diagnostic, de la (violence de la) psychiatrie, de l’(a)normalité, je vous conseille le roman-autobiographique-recherche-documentaire Mon vrai nom est Elisabeth, d’Adèle Yon, dont je ne mets ici qu’un petit extrait, pour ne pas divulgâcher.
Si je devais qualifier la relation qui se noue alors avec cette arrière-grand-mère que je n'ai pas connue, si j'avais suffisamment de souvenirs de cette période obscure qu'est l'adolescence pour le faire, je dirais que son idée fait naître ma première véritable peur : celle d'être folle.
Il y a certains passages très durs et on plonge dans la lecture comme en apnée, mais ça vaut vraiment le coup.
*
Nos rencontres enfantines avec la douleur physique, qui ne manque pas de grêler lors de nombreux actes médicaux, sera très rapidement passée sous silence par les praticiens et/ou les parents, le subterfuge du courage donnant lieu a priori à une valorisation de la volonté de l'enfant a faire face à la douleur. Enrôlement du petit soldat dont on promet bien souvent la victoire d'une guérison. Mais à posteriori, il ne sera permis à l'enfant d'établir aucun dialogue sur les douleurs physiques – et alors, forcément aussi psychiques – qu'il traverse, autant qu'il n'aura accès à aucun accord de limite. Et la suite du piège consiste en ce que le courage à l'horreur ne cesse d'être encouragé. « Tu as été courageux, nous sommes fiers de toi » s'enchaînera souvent d’une prochaine épreuve douloureuse réclamant : « Sois encore courageux, serre les dents. » Le courage, ici capitalisable à l'infini, déshumanise l'acteur courageux, l’actrice courageuse, au profit de l'acte médical et lorsqu'adolescent, l'handi voudra rompre cet engrenage du courage en refusant catégoriquement des actes médicaux pénibles, il lui sera reproché de « ne pas être bien courageux » ; lui-même sera accusé de rébellion et n'aura jamais aucune légitimité à remettre en question ces propos. L'absurdité de l'injonction au courage est soulignée par Hannah Arendt à propos d'Eichmann répondant au juge qu'il aurait été courageux « si le courage avait été structuré hiérarchiquement », si on lui en avait donné l'ordre: H. Arendt invalide le caractère inaugural du courage, en cela que le fait d'être courageux ne peut jamais être l'effet d'une obéissance à l'injonction de l'être.
J’ai lu Les noces du courage et du handicap, du militant autonomiste handicapé Zig Blanquer, qui fait écho à l'article de Helene Kane : "Le contrôle des comportements de l'enfant lors de soins potentiellement douloureux : l'éducatif au détour des gestes médicaux".
J’ai été également très touchée par le texte Le vif du sujet, terrible de rage, de vitalité et d’esprit. Un recueil de ses textes a été réédité chez Tahin Party, dans un petit livre intitulé Nos existences handies, et je ne peux qu’en recommander la lecture. On le trouve en librairies, mais aussi en ligne, merci Tahin Party !
*
J’ai lu ce livre car ces derniers mois je me suis intéressée de très près à la question (au risque, devrais-je dire) de la potentielle légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté en France. J’en avais déjà parlé il y a 4 ans, et il y a 2 ans. Et il est impossible de penser cette question éthique et politique sans l’apport théorique des militants et militantes handicapées, comme Zig Blanquer et tant d’autres. Et comme cette lettre est déjà bien longue, je vous invite à regarder cette vidéo qui dure moins de 5 minutes, où l’avocate et militante pour les droits des personnes handicapées, Elisa Rojas, présente les enjeux de cette loi de façon critique, depuis un référentiel politique de gauche et antivalidiste que l’on entend encore trop peu dans les médias mainstream.